Le réseau Cuma en Pologne !
Publié le
16 animateurs du réseau Cuma ont participé au voyage en Pologne d’étude organisé par la FNCuma et son partenaire SaMASZ. Retour en photos, accompagné de quelques références sur ce voyage qui a marqué les participants et leur a donné une vision différente sur l'agriculture polonaise.
Visite des exploitations agricoles polonaises
L’agriculture polonaise présente une diversité de production assez importante avec des exploitations de petite taille très nombreuses (taille moyenne de 11 hectares) qui coexistent avec des exploitations de grande taille – moins nombreuses – qui peuvent dépasser les 4 000 hectares. La tendance actuelle semble s’orienter vers l’agrandissement des exploitations de petite taille (inférieur à 7 hectares) au profit des exploitations de moyenne ou grande taille. Les plus grandes exploitations agricoles de Pologne — environ 2 400 fermes dépassant les 300 hectares — sont concentrées dans l’Ouest et le Nord du pays, sur d’anciennes terres allemandes autrefois collectivisées et jamais démembrées. À l’inverse, les plus petites exploitations se situent principalement dans le Sud-Est. En moyenne, les exploitations polonaises comptent parmi les plus petites de l’Union européenne.
Entre 25 % et 30 % de la production agricole nationale n’est pas commercialisée mais consommée sur place, notamment dans les productions végétales, dont 40 % restent en autoconsommation (contre 10 % pour les productions animales).
Près de 60 % des familles agricoles déclarent ne pas produire à titre commercial. Seule une famille sur dix vit exclusivement de son activité agricole, tandis qu’environ un tiers combine une production commercialisée et une activité non agricole.
Ce modèle hybride repose sur un système de semi-subsistance, articulant autoconsommation et revenus familiaux externes, caractéristique d’une agriculture encore en transition entre logique de marché et équilibre domestique.
Comparaison synthétique à 2020 entre France / Pologne (source: EuroStat) | ||
|---|---|---|
|
Indicateur |
France (2020) |
Pologne (2020) |
|
SAU totale |
~27,9 Mha |
~14,7 Mha |
|
% du territoire national |
~52 % |
~48 % |
|
Nombre d’exploitations |
~389 000 |
~1 300 000 |
|
SAU moyenne / exploitation |
~70 ha |
~11 ha |
|
Type dominant d’exploitation |
Moyenne à Grandes exploitations |
Petites exploitations familiales |
|
Structure foncière |
Concentrée, mécanisée |
Morcelée, main-d’œuvre familiale |
|
Évolution 2010–2020 |
−21 % d’exploitations, SAU stable |
−13 % d’exploitations, SAU moyenne |
Nous avons visité deux types d’exploitations orientées élevage, représentatives des exploitations polonaises. Une exploitation de taille moyenne (60 laitières) et une exploitation de grande taille (700 bovins). Les deux exploitations sont en élevage hors sol plutôt intensif.
La mécanisation agricole en Pologne : une détention des machines plutôt individuelle mais une forte entraide entre agriculteur
Peu “d’attachement” aux marques de matériel, sur les deux exploitations observées, nous avons constaté une grande diversité de matériels, pour la plupart détenus en propre. Le système de Cuma tel qu’il existe en France n’est pas présent en Pologne. Cependant, une forme d’entraide agricole demeure très active : les agriculteurs partagent régulièrement leur matériel ou leur main-d’œuvre de manière informelle.
À titre d’exemple, l’agriculteur Jakać Borki, rencontré lors de la première visite, expliquait pouvoir utiliser le matériel de ses voisins sans même avoir besoin de le leur demander, à condition qu’il soit disponible sur la ferme.
Les chaînes de mécanisation rencontrées présentent souvent du matériel neuf ou récent, reflet direct des programmes européens de modernisation des exploitations. La Pologne, longtemps connue comme un marché de destination pour le matériel agricole d’occasion venu d’Europe occidentale (dont de France), connaît aujourd’hui une évolution notable : les agriculteurs dont la SAU dépasse les 30 hectares, investissent dans des équipements neufs et deviennent à leur tour, des fournisseurs de matériel d’occasion pour des pays comme la Bulgarie, la Roumanie ou l’Ukraine.
Pour autant, selon une enquête menée en mai 2019 auprès de 1584 agriculteurs par le cabinet Martin & Jacob pour le compte de la filiale polonaise de Kubota, les petites exploitations polonaises majoritaires, privilégient les tracteurs d’occasion : plus de la moitié de ceux qui envisagent d’en acheter un (53,9 %) ont fait ce choix. Les ventes de tracteurs en Pologne sont estimées à 25 000 tracteurs en 2019, presque autant qu’en France mais avec des puissances plus faibles. Selon toujours cette enquête, 67,9 % des éleveurs laitiers et 65,5 % des éleveurs de bovins envisagent l’achat d’un tracteur d’occasion. Fait intéressant, dans plus de 71 % des cas, l’achat se fera au comptant (grâce aux économies de l’agriculteur). 44,2 % des exploitations céréalières et 31,7 % des exploitations laitières prévoient d’acheter des tracteurs neufs. Dans ce cas, la plupart des acheteurs, outre leur investissement sur fonds propres, auront recours à des aides européennes (47,3 %) ou à d’autres solutions, comme le financement par l’usine (35,2 %).
Par ailleurs, les exploitants rencontrés lors de la visite témoignent d’un faible attachement aux marques. La diversité des origines des matériels illustre leur pragmatisme : ils privilégient avant tout la qualité du service et le prix d’achat, sans chercher à se lier durablement à un constructeur ou un équipementier spécifique.
Une performance économique soutenue par un marché porteur orienté à l’export et des coopératives qui soutiennent leurs adhérents
Lors des échanges avec les deux agriculteurs, il s’est parfois avéré difficile d’obtenir des données économiques ou techniques précises. Quelques chiffres clés méritent néanmoins d’être soulignés.
La productivité laitière atteint en moyenne 11 000 kg de lait par vache et par an, contre 8 500 kg/an en France. Par ailleurs, la qualité du lait associée à un marché national très porteur permet aux éleveurs polonais d’obtenir des prix particulièrement élevés : environ 710€ pour 1 000 litres, et ce, sans label ni appellation spécifique. À titre de comparaison, en France, même le lait certifié biologique atteint péniblement 520€ pour 1 000 litres.
Les coopératives ont mis en place un système de cotisation par litre de lait livré, permettant aux éleveurs adhérents de constituer progressivement une épargne mutualisée. Ce dispositif leur ouvre droit à un avantage financier au moment du départ à la retraite et peut, le cas échéant, être mobilisé en cas de difficultés économiques rencontrées par les adhérents. Cela peut représenter plusieurs dizaines milliers d’euros.
Le foncier, un grand frein à l’installation et/ou à l’agrandissement
Autre constat commun aux deux exploitations rencontrées, est l’accès au foncier. Le prix d’un hectare de terre de bonne qualité (classe 4 sur 6 ) tel que qu’il est pratiqué dans la région des deux exploitations visitées, avoisine 50 000€/ha. Selon les dires des exploitants, il y a très peu de terres en vente dans leur région. A titre de comparaison, un hectare de terre de la même catégorie coûte environ 15 000€/ha en France.
Le fermage est peu pratiqué en Pologne contrairement à la France qui concerne plus des trois quarts de la SAU métropolitaine.
Un système d’élevage intensif pour une production laitière très performante économiquement.
Cette exploitation de 200 hectares et plus de 700 bovins dont environ 350 vaches laitières, est basée sur une alimentation axée essentiellement sur la luzerne et le maïs produit localement. Les surfaces cultivées n’étant pas suffisantes pour alimenter ce troupeau, l’agriculteur rencontré, fait appel à d’autres agriculteurs pour leur racheter des fourrages. La production de luzerne qui peut atteindre 6 coupes par an (3 à 4 coupes en France) renouvelée tous les 5 ans en moyenne, permet d’avoir des coûts d’alimentation très compétitifs. La chaîne de récolte pour la luzerne, se fait exclusivement en vrac via des remorques autochargeuses. Ils stockent essentiellement en silo taupe ce qui lui évite des frais de construction de silos. L’agriculteur qui a déjà visité des exploitations agricoles en France, trouve que la chaîne de récolte basée sur l’enrubannage est un non sens économique et rend le coût de l’alimentation élevé. En France, un combiné presse enrubanneuse coûte environ 80 000€ à 100 000€ pour un coût d’enrubannage d’environ 6 à 7€ par balle.

Échange avec le propriétaire de l’exploitation qui emploie 4 à 5 salariés pour s’occuper des différentes tâches sur la ferme. La difficulté de recrutement et surtout de fidélisation des salariés est présente aussi en Pologne. Quand on trouve un bon salarié, on fait tout pour le garder. Une maison est mise à disposition des salariés à proximité de la ferme pour les fidéliser.

Échange avec l’éleveur sur le choix de la chaîne de récolte et l’alimentation du troupeau. En arrière plan, un ensemble tracteur/remorque autochargeuse qui assure la récolte des fourrages verts notamment la luzerne.

Les besoins de puissance peuvent paraître surdimensionnés : renouvellement régulier de 6 tracteurs sur la ferme de plusieurs marques (Valtra, Deutz, John Deere, Fendt…). 3 autochargeuses sont utilisées pour transporter le fourrage vert. (Krone, Pottinger, Lely).

Une gamme de matériel très diversifié détenue en propre. Une partie de la récolte notamment du maïs est assuré avec une ensileuse appartenant à un agriculteur/entrepreneur.
La majorité des tâches sont mécanisées y compris le repousse fourrage. Le fourrage est déposé par une désileuse sur plate forme carrelée puis repousser régulièrement avec un porte-outils compact équipé de vis sans fin.

Le couple au centre de la photo est à la tête de l’élevage. Le renouvellement des générations dans les exploitations laitières polonaises ne semble pas poser de difficultés. Le contexte économique favorable de la filière soutient la transmission des exploitations et encourage l’installation des jeunes agriculteurs.

Les coopératives laitières sont très exigeantes sur la qualité du lait livré. La salle de traite est nettoyée en permanence pour garantir une qualité et un prix rémunérateur.
Visite l’usine Samasz


L’usine regroupe plus de 700 employés et a un projet d’embauche de 400 emplois supplémentaires.
Le fondateur de SaMASZ a démarré son activité avec des arracheuses de pomme de terre. Il a vendu une vingtaine de modèles avant d’arrêter cette activité, pour se concentrer sur les outils de récolte de fourrage.
Toute l’histoire de l’entreprise SaMASZ est racontée sur une grande fresque murale, avec les dates clés, depuis la création d’un petit atelier de fabrication créé en 1984 par le fondateur de l’usine jusqu’à aujourd’hui, en passant par la construction de la nouvelle usine que nous avons visitée qui date de 2016. L’ancienne atelier/usine est loué à d’autres entreprises/prestataires industriels.


La plus grosse et ancienne machine outil de l’usine qui fonctionne encore aujourd’hui : une presse de 350 tonnes qui sert à l’emboutissage de l’acier pour donner forme aux assiettes des faucheuses SaMASZ. La nouvelle usine qui date de 2016, est conçue autour de cette machine outil dont l’installation nécessite des fondations et une logistique assez complexe.
Les vieilles machines outil, côtoient des outils ultra modernes. ici une machine de découpe ultra rapide qui peut traiter jusqu’à 4 000 tonnes d’acier par an.
Lors d’un échange avec les ingénieurs du bureau R&D, plusieurs innovations ont été présentées concernant les faucheuses. Les parties réglables de ces machines sont désormais peintes en rouge afin de faciliter leur identification et leur réglage. Une autre innovation, protégée par un brevet, permet aux extrémités des faucheuses frontales de se replier grâce à un système simple combinant une ligne hydraulique et un vérin à gaz, ce qui évite l’usage de multiples prises hydrauliques sur le tracteur. Enfin, les combinés de fauche intègrent désormais la technologie ISOBUS, certifiée par l’AEF, offrant une compatibilité entre différentes marques de faucheuses et de tracteurs — un avantage notable pour les Cuma qui peuvent ainsi mixer leurs équipements sans contrainte de compatibilité.

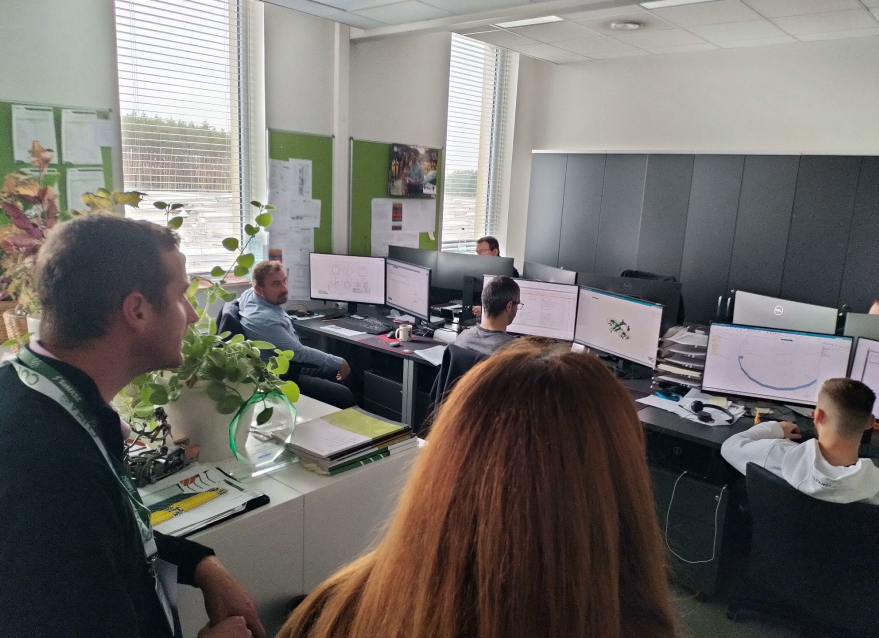
Nous avons pu échanger avec les ingénieurs du bureau de R&D. Une collaboration étroite unit l’Université polytechnique de Bialystok et les ingénieurs de SaMASZ. Un professeur de l’université, intervenant régulier pour l’usine, participe aux travaux de veille technologique et de protection des innovations (brevets, recherches,…). À noter qu’il est rare qu’un constructeur ouvre ainsi les portes de son service R&D à des visiteurs extérieurs. Ce geste témoigne de la relation de confiance que les responsables de SaMASZ accordent au réseau Cuma.
Parmi les nouveaux produits proposés par SaMASZ, des andaineurs à tapis. L’avantage concurrentiel de ces produits : un faible encombrement et un rapport prix/qualité avantageux. Nous avons eu l’occasion de voir le prototype qui a servi à développer le modèle commercialisé actuellement. 2 ans de développement sont nécessaires pour mettre en place le modèle actuel.
Certains andaineurs du marché achetés en Cuma ont connu des déboires liés notamment au bourrage. Samasz à trouvé l’astuce pour éviter cela. Une technologie de ratissage par cames couplée à des pallets qui empêchent le fourrage s’enrouler autour des dents à l’origine des bourrages.
Un accueil chaleureux


Nous avons eu la chance d’être accueilli par le fondateur de SaMASZ. Depuis ses débuts modestes, SaMASZ est devenu un important fabricant européen et international de machines agricoles pour la récolte de fourrage vert, devenant ainsi l’un des leaders du secteur.
Antoni Stolarski a décrit sa passion pour la construction de machines agricoles et n’avait jamais imaginé un jour devenir un acteur aussi important malgré son ambition. C’est exactement en 1984 qu’il commença à fabriquer des machines agricoles dans un garage loué.
Une entreprise qu’il a désormais transmis à ses trois enfants, qui perpétuent le savoir-faire familial.
L’équipe Entraid/FNCuma a offert au fondateur de SaMASZ une statuette en verre représentant un combattant de MMA, façonnée à la main par un artisan Breton. Ce choix symbolique rend hommage à la passion que partage la famille d’Antoni Stolarski pour ce sport.
Le fondateur a terminé en exprimant son intérêt pour le modèle coopératif des Cuma, qu’il considère comme une approche pertinente et inspirante pour l’agriculture polonaise. Il souhaite désormais contribuer à la diffusion de ce modèle en Pologne, en devenant l’un de ses ambassadeurs convaincus.